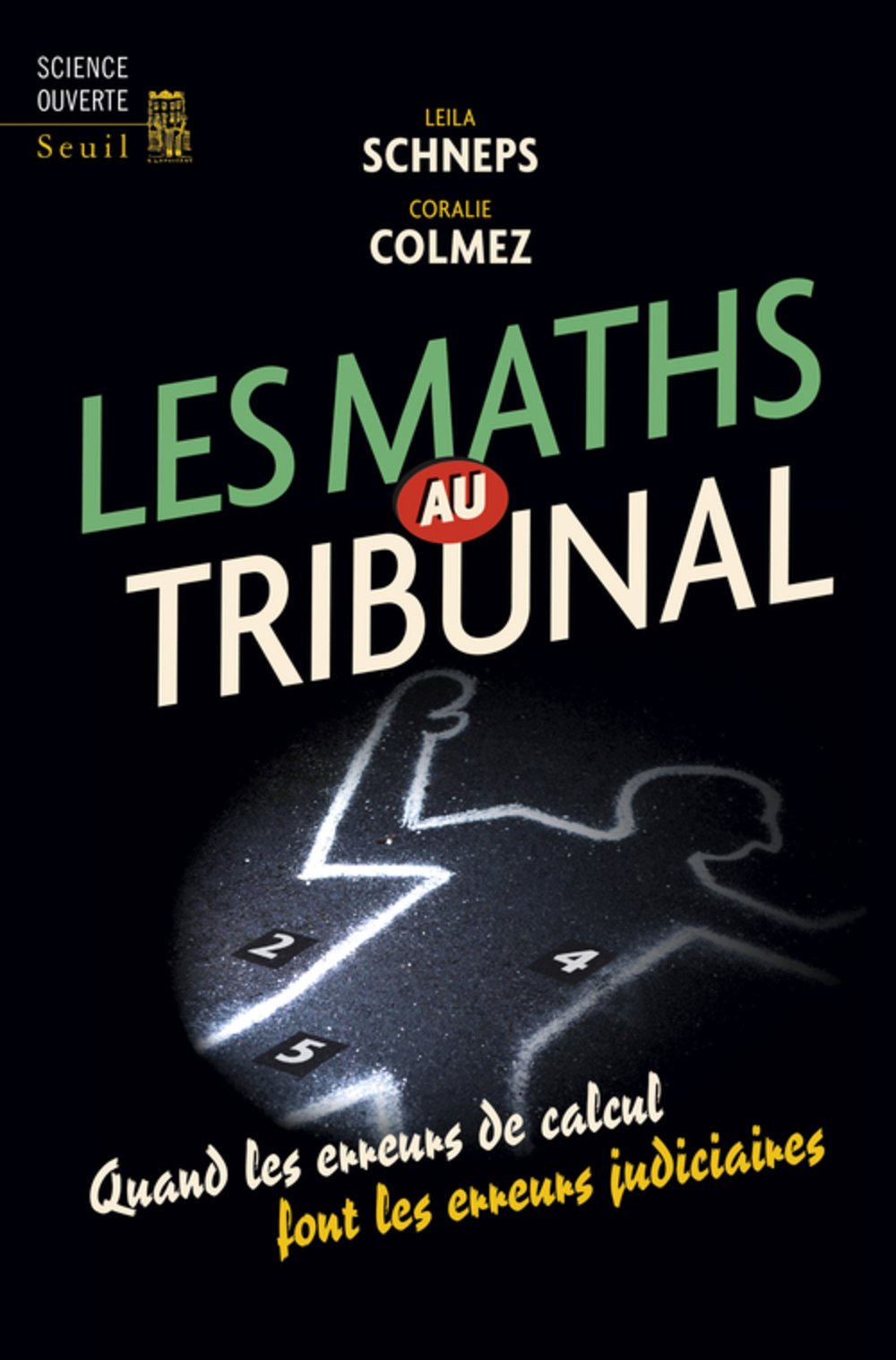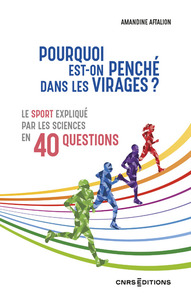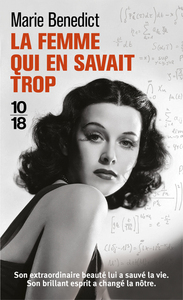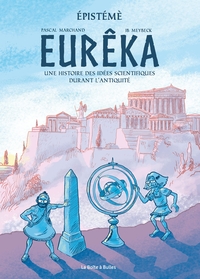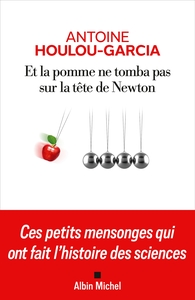Contrairement à ce qu’annonce l’exergue de la couverture, Quand les erreurs de calculs font les erreurs judiciaires, le dernier livre de Leila Schneps ne parle pas d’erreurs de calcul, mais d’erreurs d’appréciation ou d’interprétation de résultats. Dans tous les « cas » présentés, il est bien montré que les conséquences, parfois désastreuses, proviennent de confusions, volontaires ou non, issues des personnes qui affirment appliquer des raisonnements mathématiques.
Confusion entre « hypothèses » de raisonnement et « modèles » non prouvés, confusion entre démarches de logique mathématique et démarches d’investigation policière, confusion entre « démonstrations » argumentatives et vraies démonstrations mathématiques.
La formation insuffisante des acteurs de ces drames les conduit ainsi à de grossières erreurs de méthodologie et d’interprétation. Il n’y a en fait que les calculs qui sont justes !
Le livre, passionnant, présente de façon très documentée des cas d’erreurs judiciaires en détaillant le type d’erreurs commises lors de l’enquête ou au cours des réquisitoires, erreurs ayant souvent conduit à emprisonner des innocents. Deux exemples classiques : multiplier des probabilités d’évènements non indépendants ou considérer qu’un événement à faible probabilité devient, quand il se produit, un indice de culpabilité.
Tout cela nous rappelle que même si l’équité parfaite est l’objectif de la justice, cette dernière demeure humaine, et que les « preuves » judiciaires n’ont souvent pas la rigueur qu’on devrait attendre d’elles.